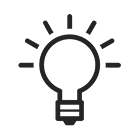Alors que la Convention citoyenne sur la fin de vie doit rendre ses conclusions au Gouvernement, dimanche 2 avril, l’opportunité d’une nouvelle loi se pose : ne suffirait-il pas d’appliquer la loi qui ne l’a pas été jusque-là ?
En France, en 2023, 61% de la population meurt désormais à l’hôpital, 12% en EHPAD et 27% à domicile. Sur 96 départements, 22 ne sont toujours pas dotés d’unités de soins palliatifs (SP) et 100 000 patients en fin de vie par an n’y ont donc pas accès.
La prolongation médicale de la vie entraîne parfois des conséquences peu compatibles avec la qualité de celle-ci. Le recours à une médecine de pointe, nécessaire dans bien des cas pour assurer la survie et le rétablissement d’un individu, s’avère plus discutable lorsque, l’échéance finale étant inéluctable, il confine à l’acharnement.
Jusqu’où peut aller le médecin ? L’individu peut-il avoir une totale maîtrise sur sa vie et sa mort ? Quelle attitude adopter lorsque le patient est privé de la capacité à exprimer sa volonté ?
Une question qui ne s’éteint pas
La personne arrivée au terme de sa vie, bien souvent fragilisée et vulnérable doit être écoutée et entendue afin que ses douleurs physiques et morales soient prises en compte et que sa dignité soit totalement respectée. Certains gestes et attitudes concernant notamment le développement des soins palliatifs, l’accompagnement des mourants et le refus de l’acharnement thérapeutique sont aujourd’hui très bien acceptés, d’autres sont sujets à de vives polémiques, voire même totalement prohibés.
A lire aussi : Intelligence artificielle : aimeriez-vous être soigné par un robot ?
La frontière entre ces gestes est parfois ténue et le législateur se devait de prendre clairement position sur ce thème délicat de la fin de vie. Il l’a fait à deux reprises et remet la question sur le devant de la scène aujourd’hui, alors que la convention citoyenne mise en place pour débattre du suicide assisté se prononcera, dimanche 2 avril, en sa faveur ou non.
La fin de la vie à la lumière du passé
Pour comprendre le débat qui se joue en ce moment il faut revenir sur les définitions des termes et faire un retour en arrière pour voir comment le passé éclaire l’avenir sur cette question délicate.
Une confusion persiste entre trois pratiques de fin de vie :
– la limitation et l’arrêt des thérapeutiques actives,
– les soins palliatifs
– et l’acte délibéré de provoquer la mort.
Il faut distinguer avec précision les limitations et l’arrêt de traitements devenus inutiles ou refusés par le patient – pratiques tout à fait légitimes – de l’acte de provoquer délibérément la mort, soit par euthanasie soit en aidant au suicide.
Une seule forme d’euthanasie
En grec, le terme « euthanasie » (« eu tanatos ») signifie « bonne, agréable » et « mort ». Littéralement, l’euthanasie signifie donc « mort agréable ». Et c’est évidemment ce que chacun peut souhaiter. Mais dans son sens commun, l’euthanasie est une action ou une omission intentionnelle, le but recherché est la mort du malade pour supprimer sa douleur ; elle se définit par une intention (donner la mort), un but recherché (pour supprimer la douleur) et des moyens mis en œuvre (action ou omission). Il s’agit donc d’une mort imposée, par opposition à la mort naturelle.
On perçoit, dès lors, aisément que la distinction entre euthanasie passive et euthanasie active n’a pas lieu d’être et fausse le débat. Soit il y a euthanasie par action ou par omission (en injectant un produit létal ou en « oubliant » de donner à boire), c’est-à-dire une volonté de mettre un terme à la vie du patient, soit il y a volonté d’accompagner le patient en atténuant ses souffrances, c’est-à-dire passer du domaine de l’acharnement thérapeutique à celui des soins palliatifs. La distinction entre l’euthanasie et l’interruption de soins disproportionnés est essentielle.
Poser les termes
En France, à ce jour, au nom de l’interdit de tuer qui constitue le fondement de la société française, comme l’expliquait en substance Philippe Douste-Blazy, alors ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille, dans son discours au Sénat relatif à la proposition de loi de 2005, l’euthanasie est condamnée. Position qui est d’ailleurs soutenue par des praticiens reconnus.
La pratique du « suicide assisté », qui consiste à donner des médicaments ou à mettre du poison dans la seringue et à faire appuyer le malade lui-même afin d’éviter les poursuites, est également condamnée en France même si sa légalisation est aujourd’hui en discussion.
Le terme se distingue enfin de « l’assistance au suicide ». Dans ce cas, le produit létal est prescrit à la personne malade. Libre à elle de l’acheter et de l’absorber.
Ce qui est consacré par la loi de 2005 et la loi Claeys-Léonetti de 2016 est le rejet de l’acharnement thérapeutique. En effet la poursuite d’un traitement lourd, inutile et disproportionné par rapport au bien qu’en retire le patient est condamnée tant par les instances religieuses qu’éthiques et déontologiques.
Par soins palliatifs, on entend l’accompagnement du malade et l’utilisation d’antalgiques pour soulager la douleur, même si cela amène à prendre des risques parfois mortels. Le but n’est pas ici de donner la mort au patient, mais « de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle », selon la définition de la Société française d’Accompagnement et de Soins palliatifs.
L’accompagnement des personnes en fin de vie est le véritable enjeu du débat sur l’euthanasie. La question de la fin de vie est extrêmement complexe et fait appel à des notions aussi diverses que contradictoires, ce qui rend le travail législatif particulièrement ardu.
Un débat vieux de 40 ans
Le principe posé par l’article 16 du code civil est celui de la dignité du corps humain et corrélativement celui de son indisponibilité. L’article 16-3 du même code fait valoir « qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Cet article vise indirectement les pratiques euthanasiques, dès lors que celles-ci portent naturellement atteinte à l’intégrité du corps humain, et ne peuvent être justifiées par aucune nécessité médicale.
Le débat sur la fin de vie a réellement commencé dans les années 80, quand la presse et l’opinion française se sont émues des conditions de souffrances et d’isolement dans lesquelles de nombreuses personnes terminaient leurs jours et ont pris conscience que des pratiques d’euthanasie clandestines existaient au sein même des hôpitaux.
Entre 1980 et 1985, une campagne est menée en faveur de la reconnaissance légale de l’euthanasie avec le soutien de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) à travers son « testament de vie ». Mais elle a eu de nombreux détracteurs, tant dans le monde médical que chez les intellectuels ou chez les religieux qui ont proposé une alternative à leur proposition : celle de mettre en place un « accompagnement des mourants ».
Le tournant de 1986
Le grand tournant en la matière date de 1986. La circulaire du 26 août 1986 est d’une importance considérable. Elle porte sur l’organisation des soins et l’accompagnement des malades en phase terminale. Et dès 1987, des unités de soins palliatifs sont créées en France ; le premier service s’est ouvert à l’Institut mutualiste de Montsouris. Depuis 1991, ces soins font partie des missions de l’hôpital, leur accès est présenté comme un droit des malades. La loi du 4 février 1995 fait même obligation aux professionnels de la santé de prendre en charge la douleur des patients et le code de déontologie médicale inscrit le soulagement de la douleur parmi les devoirs des médecins. Ces derniers doivent s’efforcer de soulager les souffrances du malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et ce en toutes circonstances. Le code précise également qu’il convient d’accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, d’assurer par des soins et des mesures appropriées la qualité d’une vie qui prend fin, de sauvegarder la dignité du malade et de réconforter son entourage.
Mais c’est la loi du 9 juin 1999 qui a officialisé la pratique des soins palliatifs et poser comme principe que « toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». Cette loi a notamment créé un congé spécifique d’accompagnement d’une personne en fin de vie, permettant ainsi de s’occuper d’un parent ou de toute autre personne.
En la votant, les parlementaires se sont conformés à l’esprit du projet de recommandation du Conseil de l’Europe, rendu public en mai 1999, et dont l’objectif est d’assurer aux malades incurables et aux mourants le droit aux soins palliatifs.
Cette loi a été complétée par celle du 4 mars 2002, sur les droits des malades et la qualité du système de santé. Elle opère une véritable révolution, en érigeant comme principes essentiels le droit de tout patient à être informé sur son état de santé et à prendre les décisions concernant sa santé.
A priori, les textes et la jurisprudence semblaient suffisants pour éclairer médecins et soignants quant à l’attitude à adopter devant un patient en grande souffrance et en fin de vie. Mais deux affaires françaises sont venues raviver le débat et ont obligé le législateur à revoir sa copie.
Et le débat reprit vie
La première est l’histoire de Christine Malèvre, une infirmière en charge de personnes âgées et souffrantes. Elle estimait que certains patients seraient plus heureux morts et en a fait passer sept de vie à trépas, sans requérir leur consentement ou celui des familles, et sans faire état à qui que ce soit de sa décision personnelle et secrète. En l’espèce, l’euthanasie était caractérisée et le juge d’instruction a qualifié ces actes d’assassinats.
La seconde est l’affaire Vincent Humbert, du nom d’un jeune homme tétraplégique hospitalisé pendant trois ans, qui souhaitait mourir et qui, après avoir formulé cette demande à plusieurs reprises, y a été aidé par sa mère, Marie. Plongé dans un profond coma après que cette dernière lui a injecté des barbituriques en septembre 2003, il a été admis en réanimation au centre héliomarin de Berck-sur-Mer. Au bout de deux jours, le docteur Chaussoy a décidé l’arrêt de la ventilation et a procédé à l’injection de chlorure de potassium. Ce dernier a été mis en examen pour « empoisonnement avec préméditation », tout comme Madame Humbert. Ici, l’euthanasie montre sa facette la plus évidente : les actes incriminés ont été effectués dans le but de soulager. Mais peut-on supprimer dans le but de soulager ?
C’est à la suite du douloureux cas de Vincent Humbert qu’une commission d’accompagnement sur la fin de vie, composée de 31 membres de toutes tendances confondues, a travaillé pendant un an, auditionnant toutes les personnes susceptibles d’apporter une contribution à ce débat. Des personnalités du monde médical comme le professeur Lucien Israël, le docteur Bruno Cadart, le Professeur Bernard Debré, Marie de Hennezel, des représentants du milieu associatif, des représentants de tous les courants religieux et des juristes ont été entendus. La commission a également opéré une étude approfondie des différentes législations existantes sur ce sujet dans les pays membres de l’Union européenne.
L’émergence d’une troisième voie
Entre le choix de la dépénalisation de l’euthanasie, jugée dangereuse par les juristes et refusée par la grande majorité des médecins, et le statuquo, qui favorise les euthanasies clandestines, est apparue une troisième voie, une nouvelle loi, un point d’équilibre, de nouvelles dispositions sur le traitement et l’accompagnement des personnes mourantes.
Rapportée par Jean Léonetti, elle a été promulguée le 22 avril 2005. Le rapport en question rejette toute idée de dépénalisation de l’euthanasie. Il propose de développer une politique d’accompagnement des personnes en fin de vie selon quatre axes :
- Communiquer à propos de la fin de vie, à savoir être clair sur les définitions et les différentes pratiques liées aux soins dispensés aux malades dans le but de lever les ambiguïtés et d’éviter tout malentendu, mais aussi parler des soins palliatifs.
- Développer les soins, c’est-à-dire créer une unité de soins palliatifs dans chaque CHU, avec un personnel adapté partageant une certaine « éthique » et renforcer la présence de psychologues.
- Former les médecins en valorisant les soins palliatifs, en leur apprenant à communiquer.
- Améliorer les pratiques des personnels soignants en luttant notamment contre l’opacité dans les services confrontés aux décisions de limitation ou d’arrêt de thérapeutiques actives, comme chez les urgentistes et réanimateurs, mais également en proposant un élargissement du code de déontologie pour y intégrer les notions d’intentionnalité et de double effet.
Cette loi jugée équilibrée entre droits du patient et responsabilité du médecin accorde des droits spécifiques aux malades en fin de vie. Cette reconnaissance se traduit par des dispositions poursuivant trois objectifs : le refus de traitement par le malade conscient, l’affirmation du rôle de la personne de confiance et la prise en compte des directives anticipées de celle-ci (chargée par le malade d’exprimer sa volonté s’il n’était pas en mesure de le faire). La volonté du malade et la prise de conscience qu’il est, malgré sa faiblesse, un être humain qui a conservé tous ses attributs et non une « presque chose » est au cœur du dispositif législatif.
Les devoirs du médecin
La loi précise également les devoirs du médecin. Elle prévoit l’information la plus complète du malade, directement s’il est conscient, indirectement s’il ne l’est plus. On retrouve aussi ce devoir d’information dans le cas où le malade, conscient, refuse un traitement et met ainsi ses jours en danger, afin qu’il prenne sa décision en parfaite connaissance de cause. C’est aussi le cas lorsque le malade est précisément en fin de vie et qu’il demande l’interruption des traitements pour maîtriser ses derniers instants.
La loi recentre aussi la responsabilité du médecin sur ses véritables bases :
– le choix du traitement approprié, avec le consentement du malade, mais aussi l’interruption parfois lorsque le malade inconscient est artificiellement maintenu en vie.
– le devoir du médecin d’accompagner son patient, dans ses derniers instants, grâce aux soins palliatifs appropriés à son état.
Les objectifs de la loi ont été clairement fixés, en ce qui concerne son positionnement, le rôle pédagogique qu’elle doit jouer ou encore l’équilibre qu’elle vise à introduire entre droits et responsabilités. Mais force est de constater que les termes n’en ont absolument pas été respectés. Un peu plus de dix ans après, la volonté d’une réforme s’est donc imposée.
La loi Claeys-Léonetti du 2 février 2016 s’en est chargé, sans toutefois légaliser le suicide assisté. Elle reconnaît aux patients une longue liste de droits. Notamment celui d’être soulagé de la douleur et de bénéficier de soins palliatifs, de consentir ou, au contraire, de pouvoir refuser un traitement, de faire valoir des directives anticipées en les rendant impératives. Autre droit, celui de ne pas subir d’obstination déraisonnable de la part des soignants. Et enfin de bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès en cas de souffrances réfractaires et de pronostic à court terme.
Macron réinvente le débat
Mais le 13 septembre dernier, six ans à peine après l’adoption de la loi Claeys-Leonetti le président Emmanuel Macron décidait de rouvrir ce dossier et de lancer un grand débat national sur la fin de vie. La réflexion est confiée à une convention citoyenne composée de 184 participants tirés au sort, qui doivent rendre leurs conclusions le 2 avril 2023.
Sur la base de ces conclusions, Emmanuel Macron compte soumettre à la représentation du peuple, ou au peuple, le choix d’aller au bout du chemin qui sera proposé. Il s’est par ailleurs déclaré personnellement favorable, lors d’un déplacement en Charente-Maritime, à une évolution vers le modèle belge légalisant l’euthanasie.
Sans aller aussi loin, le Comité consultatif national d’éthique a rendu, fin février, un avis envisageant l’introduction dans le droit français d’une « aide active » à mourir, strictement encadrée, pour les malades atteints « de maladies graves et incurables provoquant des souffrances réfractaires et dont le pronostic vital est engagé à moyen terme ». Autrement dit une aide active à mourir qui reste, à ce jour, considérée comme un crime en France.
Les membre de la Convention citoyenne ont déjà été invités à participer à un premier vote le 19 février et se sont prononcés très majoritairement en faveur d’une évolution de la loi pour une « aide active à mourir » : 72% se sont prononcés en faveur d’un suicide assisté et 66% en faveur d’une euthanasie.
Une Convention et des questions
Cette méthode questionne à plusieurs égards : la première question est celle de la légitimité d’une telle convention dont les membres tirés au sort, sans compétence particulière, sans légitimité populaire vont, guidés par deux ministres du gouvernement – Olivier Véran, neurologue et porte-parole du Gouvernement, et Agnès Firmin-Le Bodo, pharmacienne et ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des professions de santé – se faire une opinion et prendre position sur ce sujet.
Un certain nombre de voix s’élèvent et de nombreux députés pensent qu’avant de modifier les textes, il faudrait pouvoir opérer un vrai bilan de la loi Claeys-Leonetti. Fadila Khattabi, présidente de la Commission des Affaires sociales, souhaite que sa commission puisse prendre « toute sa part dans le traitement de ce sujet » avec le lancement d’une mission d’évaluation transpartisane sur la loi Claeys-Leonetti. Elle précise avoir « demandé à la Cour des comptes la remise d’un rapport sur les soins palliatifs, qui sera présenté d’ici juin 2023 aux députés et devra permettre de dresser un état des lieux précis des “trous dans la raquette” dans l’organisation de ces soins, du coût que cela représente pour les finances publiques ». Le rapport « inclura également une étude comparative sur la façon dont certains pays européens appréhendent les enjeux liés à la fin de vie ».
Sur la réforme et sa pertinence plusieurs questions éthiques se posent et plusieurs opinions s’affrontent :
- Sur la question de l’euthanasie
Certaines voix souhaitent que la nouvelle loi dépénalise l’euthanasie. Jusqu’à présent, les parlementaires ont refusé d’aller sur ce terrain, estimant, comme l’avait dit en 2005 Philippe Douste-Blazy que « ce serait une erreur de dépénaliser l’interdit de tuer ». « Le « tu ne tueras point » du décalogue n’est pas seulement un principe religieux ; il est aussi un fondement de notre organisation sociale, avait repris le ministre. On ne peut pas s’engager dans la voie de la légalisation du droit de donner la mort ».
Il arrive, par exception (comme dans l’affaire Humbert), lorsque le malade n’est pas en fin de vie mais qu’il souhaite abréger ses souffrances et que l’un de ses proches exauce ses vœux, que nos institutions laissent au juge le soin de décider de la tolérance que la société est prête à leur accorder. Mais il n’est pas du ressort du législateur de décider que la vie de certaines personnes ne vaut pas d’être vécue.
Certains estiment au contraire qu’il est hypocrite de faire une différence entre donner la mort et ne pas l’empêcher. Mais la majorité des professionnels de la santé n’adhèrent pas à ce point de vue. Pour eux, la différence est éthique, elle est dans l’intention qui préside à l’acte. Permettre la mort, c’est s’incliner devant une réalité inéluctable et si le geste d’arrêter un traitement (qui s’accompagne presque toujours d’administration d’antalgiques ou de sédatifs) entraîne la mort, l’intention du geste est de restituer à la mort son « caractère naturel » et de soulager ; elle n’est pas de tuer.
Etre ferme sur ce point est absolument nécessaire, d’une part pour maintenir la relation de confiance qui lie le patient aux professionnels qui le soignent et, d’autre part, pour réaffirmer aux soignants que leur rôle n’est, en aucun cas, de donner la mort.
- Sur l’effectivité de la loi
L’ancien député Alain Claeys soutient que la très grande majorité des fins de vie pénibles et inacceptables résultent d’une mise en œuvre défaillante ou insuffisante des dispositions réglementaires en vigueur. « Normalement, la loi garantit à tous un accès égal à ces soins qui permettent de soulager jusqu’au bout les douleurs physiques et les souffrances psychologiques. Et l’on sait que, plus ils sont mis en place tôt, meilleure est la qualité de vie du patient dans la durée », souligne Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP).
Pourtant, bien que l’on manque de données actualisées, les études existantes et nombre de témoignages de soignants et de familles montrent que, malgré des progrès indéniables, il reste beaucoup à faire pour développer l’offre de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, y compris en permettant qu’ils puissent être dispensés à domicile pour s’accorder au vœu de beaucoup de Français de pouvoir mourir à domicile.
« Il faut aussi promouvoir une véritable culture des soins d’accompagnement de la personne », ajoute Alain Claeys. Cela passe par la reconnaissance universitaire de cette discipline médicale, l’information et la formation continue des soignants, le développement de la recherche pluridisciplinaire, sans oublier de renforcer la place des aidants.
Dans le cadre de certaines maladies incurables, notamment la maladie de Charcot, ou encore les maladies neuro dégénératives, des patients dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme mais qui savent que leur condition va se dégrader rapidement et que les douleurs sont difficiles, voire impossibles, à soulager même lorsqu’ils sont correctement pris en charge, réclament une aide médicale à mourir, estimant que cette vie diminuée ne mérite pas d’être vécue. À ceux-là, la loi n’offre d’autre choix que de supporter des souffrances réfractaires à tout soin jusqu’à l’agonie ou d’aller à l’étranger, en Belgique ou en Suisse.
Le monde médical ne veut pas donner la mort
« Ces situations complexes sont, paradoxalement, le résultat des progrès de la médecine », explique le professeur Régis Aubry, chef du pôle autonomie au CHU de Besançon et coordinateur du CCNE. « La très grande majorité veut vivre, mais certains vont juger que leur vie n’a plus de sens. C’est rare, voire exceptionnel, mais c’est à prendre en compte. » C’est pour ces patients que le CCNE a envisagé, dans son avis 139, rendu public le 13 septembre, l’ouverture, sous conditions strictes, « d’un accès légal à une assistance au suicide », tout en rappelant la nécessité de faire des soins palliatifs une « priorité de la politique de santé ». En général ce que souhaitent les personnes en fin de vie, ce n’est pas arrêter de vivre mais plutôt finir leur vie sans douleur ou sans angoisse excessive, sans acharnement thérapeutique, en étant entourés.
Un sondage, publié fin septembre par le journal La Croix, montre, enfin, que plus de 80 % des acteurs de soins, soignants ou bénévoles, sont défavorables à l’idée de donner intentionnellement la mort et que ce type de geste ne peut être considéré comme un soin.
La question de l’opportunité d’une nouvelle loi sur le droit de mourir dans la dignité se pose. Beaucoup d’études montrent que la loi Claeys-Léonetti n’est pas appliquée de manière satisfaisante, en l’absence d’un nombre suffisant de services de soins palliatifs. Ces structures qui ont précisément pour mission d’assister les patients en fin de vie, dans le respect de leur droit à la dignité, doivent d’abord atténuer leurs souffrances. Peut-être conviendrait-il d’appliquer convenablement la loi de 2016, qui repose précisément sur une prise en charge de cette souffrance, avant d’envisager l’euthanasie, c’est-à-dire l’absence ou l’échec de cette prise en charge ? A moins que l’on considère que l’euthanasie active est moins coûteuse que la multiplication des services de soins palliatifs ? Mais cette analyse est-elle envisageable ?
« C’est l’hôpital, en ce moment, qui est en soins palliatifs »
A cet égard Marion Muller, théologienne protestante et membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), pense qu’une telle loi n’est envisageable que dans un système de santé irréprochable. Or, pour elle, ce n’est pas le cas : « C’est l’hôpital, en ce moment, qui est en soins palliatifs. L’un des fondements de la bioéthique, c’est le consentement. À partir du moment où il n’y a pas 100% d’accès aux soins palliatifs, pas d’alternative systématique proposée à la détresse exprimée, pas de moyen pour les personnes concernées de se dire que la souffrance et les douleurs qu’elles ressentent pourraient être apaisées par une prise en charge différente, comment le consentement à une mort assistée pourrait-il être libre ? Ma position c’est : d’abord 100% d’accessibilité aux soins palliatifs, et après on discute. »
Plusieurs questions essentielles se posent aujourd’hui.
Quel nouveau rapport civilisationnel devons-nous élaborer, dans une société où l’espoir de vivre longtemps s’accroît en même temps que le nombre de personnes, âgées ou non, affligées de maladies, de handicaps et de dépendances ?
Pourquoi le médecin, qui se trouverait en position de ne plus pouvoir soigner, devrait-il être l’acteur de la bonne mort de son patient ? Existe-t-il un statut humainement soutenable pour une équipe de soignants, dont le rôle consisterait à exécuter la volonté de mourir d’une personne que, jusque-là, elle soignait ?
Enfin l’aspect économique risque de peser lourdement dans le choix de mourir. On peut craindre que des pressions familiales encouragent les personnes vulnérables ou âgées à se penser comme des fardeaux inutiles. La dérive eugéniste serait alors un véritable risque.
Comme le rappelle le pasteur Alain Houziaux, « respecter la vie, c’est aussi respecter le fait que nous ayons à mourir lorsque la vie elle-même nous quitte ».