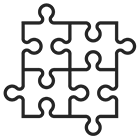La loi de Godwin énonce que « plus une discussion en ligne dure, plus la probabilité d’y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s’approche de un ». De façon plus générale, la tendance à recourir à des analogies extrêmes est grande lorsqu’un débat se prolonge. La question de l’actuelle rivalité sino-américaine semble ne pas échapper à cette règle.
Dans le domaine des relations internationales, l’idée qu’un « piège de Thucydide » pourrait se refermer sur notre planète est devenue de plus en en plus courante. Ce concept, récemment popularisé par Graham Allison, fait référence au grand général et historien athénien, auteur de La guerre du Péloponnèse qui raconte le conflit opposant Spartes à Athènes entre 431 et 404 avant notre ère. Si Thucydide est considéré comme le premier historien au sens moderne du terme, c’est que dans son ouvrage, il évacue toute explication recourant aux dieux pour privilégier une analyse rationnelle. Or, d’après lui, « la cause la plus vraie (et) aussi la moins avouée (de la guerre), c’est (…) que les Athéniens, en s’accroissant, donnèrent de l’appréhension aux Spartiates, les contraignant ainsi à la guerre ». Si l’on suit l’interprétation qu’en donne Graham Allison, une puissance hégémonique ne pourrait accepter de perdre sa primauté militaire, économique ou idéologique face à un nouveau venu et préfèrerait s’engager dans une guerre préemptive contre lui. Ce serait le cas aujourd’hui, avec les États-Unis dans le rôle de Sparte et la Chine dans celui d’Athènes.
Toute séduisante qu’elle soit, cette thèse est pourtant discutable ; elle est d’ailleurs très débattue actuellement. Comme le rappelle l’historien Barry Eichengreen, il peut être dangereux de recourir aux analogies historiques pour décrypter le présent car ces dernières dressent des parallèles hasardeux en gommant les ruptures historiques. Ainsi par exemple, les États-Unis et la Chine ne sont pas des cités-États se faisant la guerre à coups de régiments d’hoplites et vivant dans un monde à somme nulle. S’il est vrai qu’à l’époque préindustrielle, la croissance reposait sur la conquête des territoires et des ressources, dans notre monde actuel, le commerce permet à chaque pays d’accéder aux ressources de l’autre sans recourir à la guerre. Là où, auparavant, les conflits faisaient les gains de l’un et les pertes de l’autre, les échanges internationaux ont permis de générer des gains mutuels. Dans un autre registre, le fossé est énorme entre une guerre antique à dimension régionale et une guerre moderne à dimension potentiellement globale. Qu’on y pense un instant : la population de l’Attique n’excédait pas 200 000 personnes au Ve siècle avant notre ère, soit 0,1% du monde d’alors. Rien de commun avec aujourd’hui où la population combinée des États-Unis et de la Chine représente 22% du total mondial, sans compter que ces deux États disposent de l’arme nucléaire. Les déflagrations d’un conflit militaire seraient, à n’en pas douter, une catastrophe pour toutes les parties prenantes. Enfin, il existe une ambiguïté même sur la traduction que l’on donne aujourd’hui des propos de Thucydide. « L’essor » d’Athènes qui aurait suscité la « peur » des Spartiates serait à comprendre, non comme la crainte chez ces derniers de perdre leur hégémonie – une notion à laquelle ils étaient étrangers – mais plutôt comme le risque de voir certaines cités alliées de Sparte perdre leur liberté. Ainsi, le vrai « piège de Thucydide » serait de céder à la tentation de dresser des parallèles entre des situations qui n’ont rien à voir.
Il n’en demeure pas moins que cette thèse est devenue extrêmement populaire. L’une des raisons est sans nul doute l’utilisation malencontreuse de l’expression « guerre commerciale » pour désigner les tensions actuelles entre Washington et Pékin. Elle laisse entendre que les deux capitales pourraient fourbir les armes d’un futur conflit. Pourtant, l’attitude de Donald Trump, toute choquante qu’elle puisse paraître, repose sur une réelle rationalité économique et a peu en commun avec une logique de guerre. En effet, loin de vouloir la destruction de la Chine ou de son économie, le président américain réclame un échange plus « équitable » avec Pékin, motivé dans sa démarche par le profond déficit de la balance commerciale bilatérale. Pour y parvenir, l’administration Trump rejette les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et conditionne l’accès au marché étatsunien à une plus grande ouverture du marché chinois aux entreprises américaines.
Les États-Unis sont donc passés du système multilatéral de négociations de l’OMC à des relations bilatérales de marchandage. Cette évolution peut sembler en décalage avec la thèse libérale du « doux commerce », selon laquelle les échanges réduisent les conflits en créant de la confiance et de l’interdépendance. Pourtant, un État peut très bien mener une politique économique libérale-réaliste afin d’accaparer une plus grande partie des gains à l’échange, renouant avec une certaine vision mercantile des échanges. Par certains aspects d’ailleurs, les faits semblent donner raison aux pratiques de Donald Trump. Après deux années de tensions, les États-Unis et la Chine ont finalement signé un accord commercial dans lequel cette dernière s’engage à importer plus de biens des Etats-Unis et à mieux protéger les droits intellectuels des entreprises américaines. Néanmoins, ces gains à court terme sont à mettre en perspective avec les possibles pertes à plus long terme. Le mépris américains pour les règles de l’OMC, se manifestant par exemple au travers du blocage intentionnel du Tribunal d’Appel de cette organisation, pourrait signer la fin d’un ordre commercial international. Les partenaires américains pourraient imposer à leur tour des tarifs punitifs, avec le risque d’une nouvelle ère protectionniste, telle que celle que nous avons connue dans l’entre-deux-guerres.
De fait, plutôt que de considérer le différend commercial entre Washington et Pékin sous l’angle d’une « guerre » dont les journalistes seraient des Thucydide modernes, peut-être faudrait-il l’appréhender d’une autre manière ; non comme un affrontement mais plutôt comme l’oscillation endogène du monde entre phases de globalisation et déglobalisation. Qu’est-ce à dire ? La mondialisation économique génère des gains globaux. Cependant, ces gains ne sont pas répartis de manière uniforme entre pays et à l’intérieur de chacun d’eux. Il en découle une déstabilisation des relations internationales renforcée par une déstabilisation interne des sociétés. L’économiste Dani Rodrik souligne ainsi que le ratio des coûts-bénéfices politiques de l’ouverture commerciale augmente de plus en plus au fur et à mesure qu’un Etat se mondialise. Les gains incrémentaux s’amenuisent mais la redistribution des revenus entre perdants et gagnants grandit fortement. Tôt ou tard, sous la pression de leurs citoyens, certains pays tentent d’altérer la distribution des gains globaux, conduisant à la remise en cause de l’ordre économique en place, et, potentiellement, à sa chute.
Ce n’est peut-être pas par hasard que Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIème siècle qui a qualifié la vie dans un monde sans règles comme « solitaire, besogneuse, bestiale et brève », ait été l’auteur de la première traduction en anglais de l’ouvrage de Thucydide. La solution proposée par Hobbes consistait à imposer un contrat social, où la peur du souverain se substituerait à la peur de l’autre. Les relations économiques internationales actuelles demeurent encore régies, sous une forme plus douce, par ce type de contractualisme. C’est précisément ce dernier qui est en péril. Le risque aujourd’hui n’est donc pas que les États-Unis et la Chine entrent en guerre. Il réside plutôt dans le fait que la politique américaine pourrait affaiblir les grands équilibres commerciaux et politiques internationaux, garants de la stabilité mondiale.