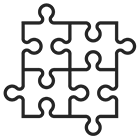L’épidémie actuelle de coronavirus place nos sociétés devant un risque que beaucoup croyaient oublié, en tout cas en Occident : la mort de masse. Que nous dit alors cette crise de notre rapport à la mort ? Que loin d’inspirer le rejet, la mort engendre un mouvement de compassion. En effet, pour la première fois de l’histoire, la quasi-totalité des pays touchés par le virus a fait le choix initial de privilégier la vie, particulièrement celle des plus âgés, au détriment de l’économie.
La mort, au cœur des sociétés par le passé
En 2020, l’ensemble du monde a brutalement redécouvert le spectre des épidémies meurtrières que l’on croyait reléguées dans le passé. Depuis quelques semaines, de nombreux articles soulignent combien l’humanité a fait face pourtant à des pandémies dans son histoire. Pensons à la grippe espagnole qui, il y a un siècle, a causé plus de morts que la Première Guerre mondiale. Ces rappels sont souvent l’occasion de souligner combien nos sociétés modernes auraient oublié la fragilité humaine au regard des catastrophes du passé en préférant refouler la mort devenue honteuse, tabou.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Dans les siècles qui nous ont précédés, la mort était éminemment présente au quotidien : tous vivaient dans sa proximité permanente. En témoignent des cimetières qui originellement entouraient l’église au sein de chaque village, en délimitant un espace sacré aux yeux de toute la communauté. Encore au siècle des Lumières d’ailleurs, un architecte comme Nicolas Ledoux faisait du cimetière l’un des lieux urbains centraux de son projet de cité idéale. C’est que le trépas donnait alors lieu à des pratiques culturelles qui associaient les vivants et les défunts. Ainsi, dès le Moyen-Âge, l’une des activités principales des ordres monastiques reposait sur la commémoration des morts dont les noms figuraient sur des obituaires c’est-à-dire des listes de personnes pour qui on célébrait une messe anniversaire en mémoire de leur décès. Prégnante, la mort était souvent précoce. Ainsi, dans un chapitre des Essais intitulé « Sur l’âge », Montaigne déclare-t-il que « mourir de vieillesse est une mort rare, exceptionnelle », un privilège réservé à ceux qui ont pu échapper aux accidents nombreux de la vie. C’est la raison pour laquelle le philosophe aquitain consacre un autre chapitre à discuter l’assertion de Cicéron selon laquelle « philosopher, c’est apprendre à mourir » ; il y conseille d’avoir continuellement présente à l’esprit l’idée de la mort, le memento mori (« souviens-toi que tu vas mourir »). A la même période d’ailleurs, en peinture, les vanités et, un peu plus tard, les natures mortes – pensons à Chardin – soulignent elles aussi, mais de façon allégorique, le passage du temps, la finitude. Rappelons qu’en 1800 encore, selon les démographes, la moitié des enfants en France mourraient avant l’âge de 10 ans et l’espérance de vie atteignait environ 30 ans. Si le décès était cause de douleur pour les proches, l’Eglise y voyait aussi la délivrance des souffrances de ce monde et l’espoir de l’entrée dans la vie éternelle.
La modernité, refoulement de la mort ?
Aujourd’hui au contraire, la mort et sa commémoration sont largement sorties du quotidien des sociétés occidentales développées. A cela, on peut voir trois raisons principales, étroitement liées. La première, et probablement la plus évidente, est que l’espérance de vie s’est allongée dans des proportions que nos aïeux n’auraient jamais espérées : en deux siècles, elle a doublé dans les pays industrialisés pour atteindre près de 80 ans. La deuxième raison tient au processus de sécularisation, c’est-à-dire la prééminence du domaine profane sur le sacré. De fait, les principaux moments de la vie – la naissance, le passage à l’âge adulte, l’entrée en couple, la mort – ont échappé à l’autorité religieuse et aux rites qu’elle prodiguait. La mort, longtemps promesse de vie éternelle, est devenue pour beaucoup une fin de parcours au sein d’un monde désenchanté. Commun à de larges parts de l’Occident, ce phénomène touche même les Etats-Unis où la pratique religieuse a longtemps été plus forte qu’en Europe. Enfin, la troisième raison tient au processus d’individualisation, notamment mis en lumière par le sociologue Norbert Elias, par lequel les hommes se perçoivent de plus en plus comme séparés les uns des autres. Dans La société des mourants, Elias estimait que cette individualisation est à l’origine du « refoulement de la mort » car elle aurait tendance à créer une distanciation entre les individus au point que les mourants susciteraient davantage de répulsion que de compassion. C’est pourquoi la fin de vie, désormais longue, se passerait de plus en plus à l’écart de la famille, dans des maisons de retraite ou à l’hôpital. Si cette thèse est largement discutée aujourd’hui, il est indéniable que le développement économique tend à rompre les liens familiaux traditionnels et à gommer pour une part la dimension collective qui autrefois entourait la mort. Cela veut-il dire pour autant qu’elle soit refoulée et que les mourants, voire les personnes très âgées, susciteraient honte et répulsion comme le soutient Elias ?
La défense de la vie avant tout
L’épidémie de coronavirus semble montrer au contraire que l’idée d’un refoulement ou d’un déni de la mort est très discutable aujourd’hui. D’abord, le nombre actuel de décès mais aussi ceux qui pourraient suivre nous confrontent au risque d’une mort de masse, impossible à nier. Et, via les médias, c’est collectivement que le monde observe les ravages du virus à tel point que l’épidémie a éveillé une sensibilité collective parfois jusqu’à l’excès. C’est probablement l’une des raisons pour laquelle un grand nombre de dirigeants politiques ont convoqué le souvenir de la guerre pour rendre compte de l’épisode que nous traversons. En outre, et contrairement à l’idée que l’on mourrait seul dans les sociétés modernes, les décès – dans l’isolement d’une chambre d’hôpital – ont choqué énormément, tant les familles qui n’avaient pas accès à leurs proches dans les derniers moments que les amis à qui on interdisait de se rendre aux obsèques. Ce refus de la présence des proches, pour d’évidentes raisons médicales, et la colère qu’il suscite soulignent combien le deuil est un processus collectif. Enfin, s’il convient d’interroger l’idée que nous mettrions la mort à distance, c’est que, pour la première fois de notre histoire, l’ensemble des pays de la planète a préféré stopper l’économie pour protéger les populations, notamment les personnes âgées ; sauver et non refouler. Il faut probablement y voir le signe de sociétés vieillissantes qui repoussent la mort et chérissent la vie. En d’autres termes, loin de la congédier, la crise manifeste une vision de la mort moins entourée de rituels collectifs mais vécue comme un drame, individuel et collectif, et non comme un tabou. Dans des sociétés sécularisées, la perspective de l’inéluctabilité de la mort donne de la valeur à la vie et pousse à la protéger par tous les moyens, comme jamais auparavant dans l’histoire. Il est encore trop tôt pour pouvoir dire si la pandémie de coronavirus constituera un tournant mais, d’ores et déjà, il semble bien qu’il faille prendre ses distances avec l’idée d’un refoulement de la mort.